14 novembre 2025
 5 min
5 min

Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.


13 novembre 2025
Le phéochromocytome du chien, une maladie rare, peut-être pas si rare

Le phéochromocytome est une tumeur neuroendocrine qui se développe à partir des cellules chromaffines de la médullosurrénale. Il présente des similarités chez le chien et chez l'homme, ce qui fait du premier un modèle d'études pour le second. Et ce qui a motivé aussi la réalisation d'une étude épidémiologique de grande ampleur dans l'espèce canine.
Exploitant à nouveau la base de données du programme britannique VetCompass, les scientifiques ont évalué la fréquence de cette affection, et en ont recherché les facteurs démographiques de risque. Ils publient leurs résultats en libre accès dans PLoS One, afin de favoriser le diagnostic de cette tumeur rare, dont les signes cliniques sont peu spécifiques.
Le phéochromocytome est effectivement responsable d'une surproduction épisodique de catécholamines (épinéphrine, norépinéphrine), entraînant des signes aspécifiques tels qu'une hypertension, une tachycardie, une faiblesse, une douleur abdominale… Sa rareté fait qu'il est probablement sous-estimé dans les diagnostics différentiels ; en médecine humaine comme en médecine vétérinaire (le diagnostic est souvent fortuit chez l'homme). Et même une fois envisagé, la confirmation du diagnostic nécessite des examens complémentaires poussés (scanner abdominal, dosage de la métanéphrine ou de la normétanéphrine dans le sang ou les urines, analyse histologique de la masse suspecte).
Cette étude dans l'espèce canine a permis d'évaluer l'incidence annuelle à 1 cas pour 100 000 chiens, ce qui est 25 fois supérieur à l'incidence chez l'homme, estimée entre 1,9 et 4,6 cas par millions.
Pour établir ce taux, les chercheurs ont analysé les dossiers médicaux de tous les chiens vus en consultation dans les cliniques vétérinaires du programme en 2019. Parmi les plus de 2,25 millions de chiens inclus, un diagnostic de phéochromocytome a été établi chez 92. La prise en compte de la date du diagnostic a permis d'évaluer l'incidence annuelle à 1 cas pour 100 000 chiens.
L'étude a surtout permis de déterminer les facteurs démographiques de risque de la tumeur. Ainsi, par comparaison aux chiens de races croisées, trois races sont significativement plus à risque : le terrier irlandais à poil doux (avec un odds ratio de 30, ce qui est considérable !), le braque allemand (odds ratio de 11) et le schnauzer nain (OD de près de 5).
D'une manière générale, les terriers sont significativement plus à risque.
Le statut sexuel est également retenu dans l'analyse multivariée, et les chiens mâles castrés sont alors significativement plus à risque de phéochromocytome.
De même, l'âge est un critère significatif, avec les chiens des deux tranches d'âge 9-12 ans et 12-15 ans identifiés comme plus à risque que les 6-9 ans. Les plus jeunes (moins de 6 ans) sont inversement moins à risque, ce qui est courant en matière de maladies tumorales.
Chez l'homme, 24 % des cas de phéochromocytome sont associés à des syndromes tumoraux héréditaires. Et chez le chien dans cette étude, les races prédisposées aux affections tumorales des glandes endocrines sont également identifiées comme plus à risque (en particulier les tumeurs sécrétantes de l'hypophyse ou des surrénales ainsi que les insulinomes). Les terriers, prédisposés ici, le sont également aux insulinomes, ce qui ouvre des perspectives de recherches sur les prédispositions à ces tumeurs, et leur socle génétique.
14 novembre 2025
 5 min
5 min

12 novembre 2025
 4 min
4 min

10 novembre 2025
 4 min
4 min

7 novembre 2025
 4 min
4 min
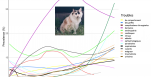
6 novembre 2025
 4 min
4 min
