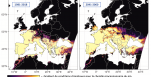5 novembre 2025
 3 min
3 min

Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.


6 novembre 2025
Collaborer avec le laboratoire d'analyses microbiologiques : les bonnes pratiques à respecter…

Les laboratoires de microbiologie vétérinaire jouent un rôle essentiel dans le diagnostic et le traitement des infections bactériennes car ils peuvent aider à répondre à trois questions :
Pour faciliter la collaboration des praticiens avec les laboratoires, l'American College of Veterinary Microbiologists (ACVM) a rédigé un guide inspiré des recommandations établies en médecine humaine par l'Infectious Disease Society of America (IDSA) et l'American Society for Microbiology (ASM) en 2024.
Quel que soit le type d'infection ou de prélèvement réalisé, les mêmes principes fondamentaux s'appliquent en effet à la médecine humaine ou vétérinaire. Les principaux points à retenir sont résumés dans ce Fil, mais l'article original détaille les conditions particulières à respecter pour confirmer et préciser l'origine d'une infection suivant les différents organes et tissus concernés.
La fiabilité des résultats de l'analyse bactériologique dépend d'abord des conditions dans lesquelles sont faits les prélèvements. En médecine humaine, les prélèvements qui ne satisfont pas aux exigences spécifiées dans le manuel de procédures du laboratoire sont d'ailleurs refusés par les microbiologistes.
Ainsi, il est toujours préférable d'envoyer au laboratoire un échantillon de tissu, d'aspirat ou de fluide plutôt qu'un frottis réalisé sur le prélèvement. Les frottis présentent en effet plusieurs inconvénients : ils peuvent être contaminés par des germes étrangers, ils contiennent des quantités de tissu ou de fluide extrêmement faibles (qui rendent délicat le transfert des bactéries à partir des fibres de l'écouvillon vers le milieu de culture) et l'inoculum provenant de l'écouvillon est rarement homogène.
Autre conseil : les prélèvements doivent être faits le plus en profondeur possible. Il est préférable d'éviter de prélever là où il existe un « bruit de fond » lié au microbiote commensal (non lié au processus pathologique), pouvant contaminer l'échantillon et fausser l'interprétation.
Dans le cas d'une plaie, une biopsie tissulaire ou une ponction sont recommandées. Les prélèvements par écouvillonnage du drainage superficiel sont moins fiables car sujets à la contamination.
Le prélèvement devrait idéalement être réalisé avant toute antibiothérapie systémique ou locale. L'administration de l'antibiotique modifie en effet le microbiote local et affecte les germes pathogènes, ce qui peut fausser les résultats de la culture.
En matière de conservation, le prélèvement sera stocké dans un récipient à ouverture large. Une ouverture trop étroite augmente effectivement le risque de contamination, à la fois lors de l'insertion puis de l'extraction du prélèvement. Les échantillons seront conservés dans un milieu de transport conforme aux instructions du laboratoire.
Les tissus, l'urine et les prélèvements de fluides destinés à une culture aérobie seront réfrigérés (la plupart des bactéries anaérobies facultatives, telles que E. coli et Streptococcus, peuvent être isolées au sein d'une culture aérobie). La réfrigération sera en revanche évitée pour les prélèvements conservés dans des flacons d'hémoculture et pour ceux destinés à une culture anaérobie (recherche de Clostridium, Bacteroides et Peptostreptococcus), pour lesquels il faut utiliser un milieu de transport spécifique.
Afin d'orienter le choix du milieu de culture, mais aussi la durée et les conditions d'incubation, les prélèvements doivent être bien documentés. Il faut notamment renseigner précisément le site de prélèvement et le contexte clinique (durée de l'infection, évolution, comorbidités, résultats cytologiques, antécédents thérapeutiques) pour que l'interprétation des résultats soit fiable.
Enfin, afin d'éviter la prolifération de bactéries opportunistes ou la disparition des bactéries les plus fragiles, les prélèvements doivent toujours être acheminés le plus rapidement possible au laboratoire, les heures d'ouverture de celui-ci conditionnant le moment propice de l'envoi.
Les prélèvements seront conditionnés en respectant les instructions données par le laboratoire ; en général, il est préférable de les envelopper dans un matériau absorbant et un double sac pour éviter les fuites.
Les conditions météorologiques doivent être prises en compte lors de l'envoi : des blocs réfrigérants peuvent par exemple être utilisés par temps chaud.
Dans tous les cas, une bonne communication entre le demandeur des analyses et le laboratoire sont des conditions essentielles à une collaboration fructueuse. Bien utilisés, les résultats des examens bactériologiques contribuent à améliorer la qualité des soins prodigués et à éviter l'émergence de résistances aux antimicrobiens.
5 novembre 2025
 3 min
3 min

4 novembre 2025
 5 min
5 min

3 novembre 2025
 6 min
6 min

31 octobre 2025
 4 min
4 min

30 octobre 2025
 3 min
3 min