21 juillet 2025
 4 min
4 min
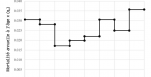
Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.


22 juillet 2025
Les staphylocoques dorés résistants à la méticilline, fréquents chez les hérissons admis en soins en France


Les hérissons d'Europe sont connus pour leur portage cutané de Staphylococcus aureus, notamment des souches résistantes à la méticilline (SARM), porteuses du gène d'antibiorésistance mecC (voir LeFil résumant une étude danoise à ce sujet). Les SARM constituent un problème de santé publique important en médecine humaine car elles sont résistances à l'ensemble des ß-lactamines. Les souches porteuses du gène mecC sont considérées comme minoritaires chez les humains, et pourraient avoir une origine animale. Ce sont toutefois les souches de SARM porteuses du gène mecA qui sont prépondérantes chez les humains (et chez les SARM du bétail).
Entre juin 2020 et avril 2021, l'équipe du centre vétérinaire de la faune sauvage et des écosystèmes d'Oniris (Nantes) a réalisé des écouvillons cutanés chez 139 hérissons, représentatifs en termes d'âge, de saison d'admission et de sexe, des 533 hérissons reçus sur la période. Les échantillons ont été prélevés aussi bien sur les animaux sans lésions cutanées (écouvillons de peau) que sur les animaux présentant des problèmes dermatologiques (écouvillons de peau et de plaies). Des cultures bactériennes sur géloses sélectives ont été suivies de PCR de confirmation de l'espèce bactérienne et de recherche des gènes de résistance. Des antibiogrammes ont aussi été réalisés. La prévalence du portage cutané de S. aureus s'est révélée très importante, avec 92 % des hérissons porteurs. En ce qui concerne l'antibiorésistance, près d'un hérisson admis en soins sur cinq (18 %) était porteur de SARM. Les souches équipées du gène de résistance mecC étaient prédominantes et représentaient 76 % des SARM, et 16 % se sont avérés porteurs du gène mecA.
Les chercheurs ont ensuite identifié un certain nombre de facteurs de risque influençant le portage de SARM. En ce qui concerne le signalement des animaux, ils ont tout d'abord identifié une augmentation du risque de portage de souche résistante à la méticilline chez les adultes en comparaison aux jeunes, chez les mâles et chez les animaux admis au printemps. Cliniquement, 92 % des hérissons porteurs de SARM présentaient des lésions cutanées, sans que ce soit significativement différent de la proportion chez les autres hérissons. La présence de "plaies sales" uniquement (sans ulcères, phlegmons ni abcès, voir le cliché ci-dessous) était un facteur prédictif de portage de SARM. Il est intéressant de noter que deux hérissons sans lésions cutanées en étaient aussi porteurs. Enfin, les hérissons provenant de zones où la densité de population humaine est importante présentaient un risque accru de portage de ces germes.
Plaie “sale” sur la tête d'un hérisson

La présence de plaies “sales” chez un hérisson admis en soins est un des facteurs de risque de portage de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Cliché : S. Larrat.
Staphylococcus aureus entre dans le diagnostic différentiel des causes ou des contributeurs aux lésions cutanées chez les hérissons. Une autre bactérie, Corynebacterium ulcerans, a été isolée à partir d'ulcères cutanés de hérissons. Dans les deux cas, ces bactéries ont un potentiel zoonotique. Il est utile de rappeler que les hérissons sont aussi fréquemment porteurs d'autres agents zoonotiques, en particulier de salmonelles, de leptospires et de dermatophytes. La prise en charge de hérissons en clinique reste tout à fait possible, mais elle requiert un respect des bonnes pratiques de biosécurité lors de la manipulation et des soins. La forte prévalence du portage de SARM représente un défi thérapeutique, compliqué par l'absence complète de données de pharmacocinétique ou pharmacodynamie des antibiotiques dans cette espèce. Chez les hérissons suspects d'infection par des staphylocoques, il serait souhaitable de soumettre des échantillons pour culture bactérienne et d'ajuster les traitements antibiotiques aux antibiogrammes. En l'absence d'examen complémentaire, ou en attendant les résultats, les ß-lactamines ne devraient pas constituer le traitement de première intention. Au vu de données issues d'une étude suédoise, il est envisageable de leur préférer des tétracyclines ou des sulfamides.
21 juillet 2025
 4 min
4 min
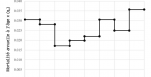
18 juillet 2025
 6 min
6 min

17 juillet 2025
 4 min
4 min

15 juillet 2025
 6 min
6 min
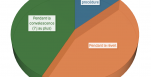
11 juillet 2025
 4 min
4 min
