17 juillet 2025
 4 min
4 min

Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.


18 juillet 2025
Cystite polypoïde : un diagnostic parfois fortuit, un pronostic favorable, mais une possible persistance
La cystite polypoïde résulte d'une inflammation chronique de la vessie, souvent secondaire à une infection urinaire ou à des calculs vésicaux. Sa pathogénèse reste toutefois imprécise. Elle entre dans le diagnostic différentiel des masses vésicales et doit notamment être distinguée des affections tumorales (les carcinomes de la vessie en particulier).
Des chercheurs américains (Université de Raleigh, Caroline du Nord) ont mené une large étude rétrospective afin de mieux connaître les caractéristiques cliniques de cette affection bénigne.
Les 112 cas inclus dans cette étude avaient été référés dans leur établissement, entre 2004 et 2020 :
Il s'agissait de 72 chiennes et 40 chiens mâles (voir tableau en illustration principale), de diverses races, formats et âges, avec toutefois une médiane à 8,5 ans, suggérant une maladie affectant plutôt les chiens d'âge moyen. Une prédisposition des femelles avait déjà été documentée.
S'agissant de cas référés et d'une maladie chronique, les signes cliniques pouvaient être présents depuis longtemps (84 jours en médiane). Le motif de consultation était principalement une hématurie (37,5 % des chiens), une strangurie (25 %), une pollakiurie (22,3 %), mais aussi une infection urinaire récurrente (14,3 % des cas) ou nouvelle (1,8 %), des calculs vésicaux (6,3 %), des mictions inappropriées (6,3 %), la présence d'une masse vésicale (3,5 %). Globalement donc des signes d'affection des voies urinaires basses. Dans quelques cas toutefois, le motif était autre, mais en lien avec la sphère urogénitale : une polyuro-polydipsie (2,7 % des cas), une insuffisance rénale aiguë (1,8 %), un écoulement vulvaire (1,8 %)…
Chez 13 chiens (soit près de 12 % des cas), l'observation des polypes vésicaux était fortuite, les animaux ne présentant aucun signe urinaire.
Les examens d'urine réalisés chez 105 chiens ont permis de confirmer ou détecter la présence d'une hématurie (64,7 % des cas) et/ou d'une pyurie (35,2 %), plus rarement d'une bactériurie (27,6 %). Une cristallurie a été observée à 24,8 %.
Lorsqu'une uroculture a été réalisée (80 cas), elle s'est révélée positive à 33 %. La proportion monte à 54,5 % en tenant compte des examens réalisés par le vétérinaire traitant avant de référer le chien. Les bactéries le plus fréquemment isolées étaient des Escherichia coli (19,7 %), des Enterococcus fecalis (7,1 %), des Staphylococcus pseudintermedius (2,5 %). Le rôle de Proteus spp., suspecté dans d'autres travaux, n'est pas confirmé.
Les radiographies abdominales (chez 26 chiens) ont permis d'observer des calculs vésicaux dans 16 cas. La cystographie (après injection de produit de contraste) a montré un épaississement de la paroi vésicale chez 2 chiens.
Finalement, une infection urinaire et/ou des calculs vésicaux étaient concomitants chez la plupart des chiens (voir tableau en illustration principale). Ces affections entraînent une irritation chronique de la muqueuse vésicale, probablement à l'origine de l'inflammation et l'hyperplasie la paroi vésicale, et par suite le développement des polypes.
En médecine humaine, la maladie est très souvent successive à un cathétérisme urinaire (aucun cas ici), parfois une fistule colovésicale, une obstruction urinaire ou des calculs, mais pas à une infection urinaire. La pathogénie semble donc différente chez l'homme et chez le chien.
L'échographie est l'examen de choix pour le diagnostic d'une cystite polypoïde. Elle a été réalisée ici chez 101 chiens, permettant de mettre en évidence des anomalies caractéristiques :
Chez 2 chiens, la paroi de la vessie était seulement irrégulière.
Le plus souvent, les polypes ou masses étaient situés au niveau de l'apex cranio-ventral de la vessie (80 % des cas, voir tableau en illustration principale). Ils se situaient au niveau du trigone à 13 % seulement, une localisation très fréquente du carcinome urothélial. Ainsi, la localisation des lésions représente un critère majeur de différenciation.
Des calculs vésicaux ont été observés à l'échographie chez 26 des chiens.
De même, une cystoscopie a été réalisée chez 48 chiens, permettant d'observer des masses polypoïdes chez 43 (89 %), uniques ou multiples, et d'autres anomalies chez 3 (muqueuse irrégulière, hyperhémie au niveau de l'apex cranio-ventral). À nouveau, les polypes se situaient le plus souvent au niveau de l'apex cranio-ventral (à 72 %).
Un examen histologique des lésions a été effectué chez 70 chiens, à partir de biopsies prélevées à la cystoscopie, par chirurgie ou plus tard à l'autopsie. Dans 5 cas, le diagnostic de cystite polypoïde a été posé en l'absence de polype ou masse observé antérieurement.
Enfin, une mutation du gène BRAF V595E a été recherchée chez 31 chiens, négative dans tous les cas. En effet, le carcinome urothélial est généralement associé à cette mutation, ce qui permet son diagnostic (à partir d'un échantillon de tissu ou d'urine).
En pratique, car outre les signes cliniques et échographiques, l'aspect macroscopique des lésions tumorales ou de cystite polypoïde est également très similaire : la distinction de ces affections repose donc sur leur localisation dans la vessie (apex versus trigone pour le carcinome urothélial) et sur les résultats de l'histologie.
Bénigne, la cystite polypoïde est de bon pronostic. Ici, le traitement médical a principalement reposé sur l'administration d'antibiotiques (65,2 % des chiens) et/ou d'anti-inflammatoires (20,5 %), afin d'éliminer la cause primaire.
Une intervention chirurgicale a été réalisée chez 36 chiens (32,1 %), dans l'objectif de retirer les polypes/masses et les calculs au besoin. Ils ont été retirés par cystoscopie chez 15 chiens.
À moyen terme (2 mois en médiane), une échographie de contrôle, réalisée chez 50 chiens, a montré une résolution de la cystite polypoïde chez 22, son amélioration chez 6 autres (réduction des lésions en nombre et/ou en taille), et un état stationnaire chez 22, mais aucun cas d'aggravation.
À plus long terme, le suivi des chiens (8 mois en médiane) a montré la persistance d'un polype chez 3 chiens (traités médicalement).
Une récurrence des signes cliniques urinaires, d'une infection ou de calculs a été observée chez 23 chiens, soit 20,5 % de la cohorte, dont seulement 6 qui avaient été traités par chirurgie. Une exérèse chirurgicale des polypes semble donc efficace.
Les polypes vésicaux peuvent prédisposer au développement d'une tumeur maligne. D'où l'importance de les détecter et les traiter. Ici toutefois, aucun chien n'a développé de tumeur maligne durant son suivi, y compris le suivi ultérieur chez le vétérinaire traitant (soit jusqu'à plus de 8 ans dans un cas).
17 juillet 2025
 4 min
4 min

15 juillet 2025
 6 min
6 min
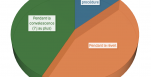
11 juillet 2025
 4 min
4 min

10 juillet 2025
 5 min
5 min

9 juillet 2025
 4 min
4 min
