21 août 2025
 4 min
4 min

Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.


21 mars 2023
Séquestre cornéen félin : plus d'un quart des chats seront ensuite touchés sur l'autre oeil
Le séquestre cornéen est une affection relativement spécifique du chat, bien que décrite occasionnellement dans d'autres espèces (chien, cheval). Sa pathogénie exacte n'est pas déterminée et son traitement n'est pas consensuel. Aussi, des cliniciens britanniques spécialisés ont-ils mené une étude rétrospective sur 72 cas, afin de déterminer l'efficacité à long terme des traitements entrepris.
Le séquestre cornéen correspond à une nécrose du stroma associée ou non à une perte de l'épithélium cornéen. Son aspect est assez caractéristique, rendant le diagnostic facile : il se présente sous la forme d'une zone arrondie d'abord ambrée, dont la pigmentation progressive aboutit à une plaque opaque bien démarquée, noire ou marron foncé, qui a tendance à faire protrusion à la surface de la cornée. Une néovascularisation et l'apparition d'un tissu de granulation peuvent être observées.
Les 72 cas de l'étude ont été pris en charge entre 2009 et 2017 (dans un même service de référés). Leur suivi sur le long terme – c'est-à-dire au moins 2 ans – était requis pour être inclus, renseigné dans le dossier médical ou en contactant les propriétaires.
Les cas de séquestre cornéen représentent ici 25 % des cas d'affections de la cornée, et 11 % de tous les cas reçus en consultation d'ophtalmologie durant la période d'étude.
Ces 72 chats confirment la prédisposition de plusieurs races, notamment le persan (25 cas) et le burmese (10 cas), mais sans exclure les « chats de gouttière » (23 cas).
Les chats brachycéphales (33/72 ici) sont également significativement plus souvent touchés. Et la conformation de la paupière (anormale dans 29 cas, dont 21 chez des brachycéphales) pourrait favoriser le développement du séquestre. Les ulcères cornéens (46 cas ici) seraient également des facteurs favorisants. L'éventuel lien avec une infection virale (herpèsvirose) n'a pas pu être analysé (faute de dépistage sur un nombre suffisant de chats).
Il s'agit de 41 chattes et 31 chats mâles (aucune prédisposition raciale n'est établie pour cette affection). L'âge moyen est de 6,9 ans.
Dans 7 cas, l'atteinte était d'emblée bilatérale. Ce qui porte à 79 le nombre d'yeux traités chez ces 72 chats.
Une atteinte unilatérale est donc observée dans 9 cas sur 10 (65/72), indépendamment de la conformation (brachycéphale ou non).
Elle touche indifféremment l'œil droit (n=39) ou gauche (n=40).
La clinique recommande un traitement chirurgical en première intention. Celui-ci a ainsi été réalisé pour 66 des 79 yeux pris en charge (84 %).
Dans les 13 autres cas, un traitement médical a été entrepris (associant larmes artificielles, AINS systémiques, antibiotiques locaux, antiviraux locaux…). Ce traitement a abouti à la disparition du séquestre dans 11 cas, après une durée médiane de 30 jours. Pour les 2 autres cas, aucun changement n'a été observé pour un, mais une perforation de la cornée est survenue chez le second, motivant une énucléation. Selon les auteurs, le risque d'aggravation et la douleur associée à la lésion dans l'attente de sa guérison spontanée fait que le traitement médical devrait être réservé aux chats pour lesquels l'intervention chirurgicale n'est pas retenue (pour des raisons de coût ou de risque anesthésique en particulier).
La chirurgie effectuée sur 66 yeux a consisté en une kératectomie superficielle, associée ou non à une greffe (greffe conjonctivale le plus souvent) : 32 yeux et 34 yeux, respectivement.
L'objectif de l'étude était de caractériser les récidives post-chirurgicales et leurs facteurs de risque.
Une récidive a ainsi été observée dans 13 des 66 yeux opérés (19 %), ce qui n'est pas une surprise compte tenu des données d'autres travaux rapportant des taux voisins. Elle apparaît après un délai médian de 245 jours.
Aucun facteur de risque de récidive n'a été identifié : technique chirurgicale, traitement prescrit avant de référer, ou prescrit après chirurgie, conformation (brachycéphalie), localisation du séquestre, environnement de vie (accès à l'extérieur)… Les chats récidivant étaient significativement plus jeunes que les autres, mais leur plus longue espérance de vie représente un biais de comparaison.
10 de ces 13 yeux ont subi une nouvelle intervention chirurgicale, sans récidive pour 9 d'entre eux, le dernier ayant été opéré une troisième fois, avec succès finalement (sans nouvelle récidive).
Lors du traitement médical, les 11 cas spontanément guéris n'ont pas récidivé.
L'atteinte ultérieure de l'œil controlatéral est fréquente, ce que confirme encore cette étude. En effet, parmi les 65 cas d'atteinte initialement unilatérale, l'atteinte de l'autre œil a été observée dans 18 cas (28 %).
Cette nouvelle lésion controlatérale survient après un délai médian de 635 jours (1,7 ans). Et à nouveau, aucun facteur de risque n'est identifié, en particulier la conformation du crâne : 10 sur les 18 cas dans cette étude sont brachycéphales.
21 août 2025
 4 min
4 min

20 août 2025
 4 min
4 min

19 août 2025
 4 min
4 min

18 août 2025
 5 min
5 min
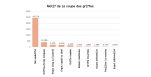
14 août 2025
 4 min
4 min
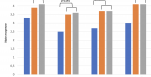
12 août 2025
 6 min
6 min





