18 juin 2025
 6 min
6 min

Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.


28 février 2023
Intoxication du chien ou du chat aux drogues récréatives : le diagnostic est difficile mais le traitement symptomatique reste de bon pronostic
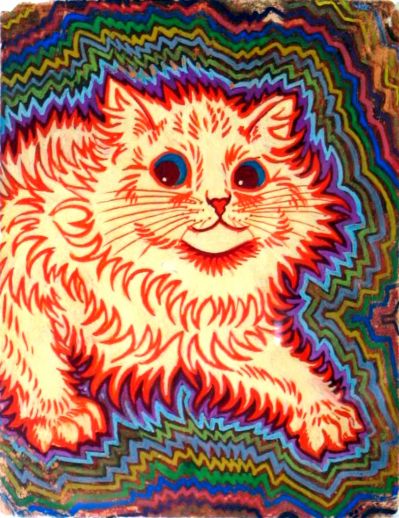
Les cas d'intoxication à des substances illicites sont heureusement assez rares chez les animaux de compagnie. Mais ils peuvent être complexes à diagnostiquer faute d'anamnèse complète, soit parce que le propriétaire n'a pas conscience que son animal a pu être exposé, soit parce qu'il ne souhaite pas révéler qu'il est détenteur ou consommateur de ces substances, quelle que soit l'origine de l'exposition (accidentelle ou intentionnelle).
Des universitaires des écoles vétérinaires de Zagreb (Croatie), Sassari et Pise (Italie) publient une synthèse bibliographique des intoxications du chien ou du chat aux principales drogues en circulation, afin d'aider le praticien dans la suspicion puis la prise en charge des cas. Bien que populaire et plus facilement accessible, le cannabis en est exclu, l'intoxication au THC, sa principale molécule psychoactive, étant par ailleurs bien documentée.
Les auteurs s'attachent surtout à décrire les signes cliniques présentés. Car à ce jour, les tests diagnostiques disponibles (essentiellement développés pour l'homme, à partir de prélèvements d'urines en particulier) manquent de fiabilité : le risque de faux positif est important.
Les amphétamines et la métamphétamine (drogue de synthèse particulièrement addictive, dénommée aussi « ice » ou « crystal », très répandue car facile et peu coûteuse à produire) sont utilisées pour leurs effets stimulants. À titre médical, les amphétamines ont d'ailleurs été initialement prescrites chez l'homme lors de déficit de l'attention avec hyperactivité ou de narcolepsie.
Chez le chien, la dose létale médiane (LD50) par voie orale se situe entre 9 et 27 mg/kg. Elle est de 10 mg/kg pour la métamphétamine, qui est d'autant plus toxique qu'elle est commercialisée plus pure.
La biodisponibilité par voie orale est élevée, avec un pic de concentration dans le sang atteint 1 à 3 heures après ingestion et une demi-vie de 6 à 12 heures. La distribution est large et le métabolisme essentiellement hépatique, la molécule étant cependant éliminée majoritairement sous forme inchangée. Les amphétamines passent la barrière hémato-encéphalique et la métamphétamine se concentre particulièrement dans le cerveau.
Ces molécules ont une forte affinité pour les récepteurs alpha et béta-adrénergiques et stimulent globalement le système nerveux sympathique.
Les signes cliniques présentés sont alors les suivants : hyperactivité, agressivité, hyperthermie, tremblements, ataxie, tachycardie, hypertension, mydriase, marcher en rond, rhabdomyolyse, dysfonctionnement cardiaque, rénal et/ou hépatique, ischémie, crises épileptiformes. Ils sont assez voisins de ceux d'une intoxication à la cocaïne. La mortalité est possible.
La MDMA (3,4-méthylènedioxyméthamphétamine), communément appelée ecstasy, est elle-aussi une drogue de synthèse, dérivée des amphétamines. Elle présente, comme la métamphétamine, des effets hallucinogènes et psychédéliques, utilisée ainsi dans le cadre festif. Ces deux drogues sont d'ailleurs régulièrement associées, ou combinées à d'autres stimulants comme la cocaïne, les cathinones (dérivées synthétiques de la cathinone naturelle, principe actif du khat), la caféine… qui aggravent les signes cliniques (notamment la caféine chez le chien et le chat).
Chez les carnivores domestiques, les signes cliniques apparaissent 30 minutes à 2 heures après ingestion. La MDMA a une action marquée de libération de la sérotonine (plutôt que la dopamine ou la noradrénaline comme observé avec la métamphétamine), causant ainsi un syndrome sérotoninergique potentiellement fatal. Un syndrome léger se manifeste par une mydriase, des frissons, une hypersudation, une légère tachycardie. Au stade supérieur, le syndrome sérotoninergique se caractérise par une triade de symptômes associant une altération de l'état mental (agitation, désorientation), une hyperactivité autonomique (tachycardie, hyperthermie) et des troubles neuromusculaires (tremblements, hyperréflexie). Chez le chien, une hypersalivation, une tachypnée, une hyperactivité sont décrits. Sans traitement, cette triade s'aggrave progressivement, avec l'apparition d'un délire, d'une hypertension, de myoclonies, etc.
La phéncyclidine ou PCP (parfois surnommée « poussière d'ange »), anciennement utilisée comme anesthésique vétérinaire, est un dissociatif utilisé pour ses effets hallucinogènes (sensation d'ivresse, sentiment de détachement du réel). La kétamine est un analogue de la PCP, mais bien moins puissant (20 à 30 fois moins).
Chez le chien, des signes cliniques marqués apparaissent dès la dose de 2,5 mg/kg PO (et les premiers signes dès 1 mg/kg), la dose de 25 mg/kg étant létale.
Très lipophile, la PCP est largement distribuée mais se concentre dans le cerveau et les tissus adipeux. Le métabolisme est principalement hépatique chez le chien, l'élimination est majoritairement rénale chez le chat (sous forme inchangée).
La PCP est un antagoniste des récepteurs NMDA, bloquant la recapture de la dopamine et la noradrénaline provoquant des effets sympathomimétiques. Elle peut aussi se fixer sur les récepteurs de l'acétylcholine et GABA.
Chez le chien, la molécule est dépressive à petites doses, stimulante à plus haute dose. Les signes cliniques sont variés : myoclonies, rictus, augmentation de l'activité motrice, incoordination, hypersalivation, nystagmus, opisthotonos, crises tonico-cloniques, agressivité, hyperthermie, tachycardie, hypertension, coma.
Le diéthyllysergamide (LSD) est un psychotrope semi-synthétique, fabriqué à partir de l'acide lysergique (issu de l'ergot de seigle, champignon parasite des céréales), aux propriétés hallucinogènes et psychostimulantes. Il a été utilisé initialement pour le traitement de divers troubles mentaux humains.
Le LSD se fixe sur les récepteurs de la sérotonine, de la dopamine et alpha-adrénergiques. Son mécanisme d'action n'est pas complètement élucidé ; il reposerait surtout sur la libération de glutamate dans le cortex cérébral.
Les connaissances de sa toxicité chez l'animal sont parcellaires. Chez l'homme, la toxicité est assez faible, les effets secondaires étant limités, de courte durée et surtout psychologiques.
Les signes cliniques chez l'animal sont peu documentés également. Ils apparaissent dans les 90 minutes après exposition et se prolongent une douzaine d'heures : mydriase, sédation, dépression ou excitation, changement de comportement, hallucinations.
La psilocybine, contenue dans les « champignons magiques », et son métabolite actif la psilocine sont des hallucinogènes produisant des effets similaires à ceux du LSD, en étant moins toxique et addictif que ce dernier. La structure de la psilocine est très voisine de celle de la sérotonine.
Les cas d'intoxication chez l'animal sont quasiment inexistants, un seul cas chez un chien a été décrit, ces champignons étant probablement peu appétents ! Les signes cliniques présentés, survenant dans les 30-60 minutes, associent ataxie, vocalisation, agressivité, hyperthermie et nystagmus.
La cocaïne est un alcaloïde d'origine naturelle, mais la drogue est commercialisée mélangée à des ingrédients inertes comme le lactose ou à des composés actifs (amphétamines, caféine, PCP), qui en augmentent la toxicité.
Les animaux de compagnie sont intoxiqués par ingestion ou inhalation (y compris chez les chiens détecteurs de drogues, à l'entraînement ou en opération).
La cocaïne est liposoluble, absorbée à environ 20 % après ingestion. Sa toxicité est plus élevée lorsqu'inhalée car lorsqu'ingérée, elle ne rejoint la circulation sanguine qu'après avoir été métabolisée (dans les intestins et le foie). Par inhalation, sa biodisponibilité atteint 80 % et son action est rapide (1 à 5 minutes). La substance traverse la barrière hémato-encéphalique.
La cocaïne augmente la libération des catécholamines et bloque la recapture de la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline.
Chez le chien, les signes d'intoxication apparaissent rapidement (après 10-15 minutes). Ils correspondent à une stimulation du système nerveux central (hyperactivité, hyperesthésie, tremblements, crises épileptiformes), puis sa dépression. D'autres symptômes sont décrits, notamment digestifs (vomissements) ou respiratoires (dyspnée, tachypnée). En cas de grave intoxication, une hyperthermie et un coma peuvent s'observer, et un décès consécutif à la dépression cardiorespiratoire induite.
Le diagnostic peut être établi par des analyses de laboratoire, identifiant la molécule en cause. Mais le traitement des intoxications à ces drogues, qu'elles soient stimulantes, dissociatives ou hallucinogènes, est finalement rarement spécifique. Et il n'attend pas le résultat des analyses. L'animal sera placé dans un environnement évitant toute stimulation (pénombre, silence) et le traitement sera symptomatique (fluidothérapie, diurétiques, traitements de soutien…).
Le recours à des émétiques ou à un lavage gastrique s'envisage au cas par cas ; leur intérêt est limité lors d'intoxication à la cocaïne ou au LSD, par exemple, qui sont rapidement absorbés. L'administration de charbon activé est généralement intéressant pour toutes ces substances liposolubles. Les émulsions lipidiques par voie intraveineuse le sont également. Le chlorure d'ammonium favorise l'élimination rénale lors d'ingestion d'amphétamines ou de PCB.
L'administration de benzodiazépines s'envisage en cas de convulsions, hyperactivité, myoclonies, etc. Ces molécules ne sont pas recommandées lors d'intoxication aux amphétamines car elles peuvent en exacerber les effets neurologiques. La phénothiazine est globalement contre-indiquée.
La cyproheptadine, antihistaminique doté de propriétés anticholinergiques et antisérotoninergiques est à considérer lors de syndrome sérotoninergique. Les bêtabloquants peuvent être utiles en cas de tachyarythmie (intoxication à la cocaïne) en prenant garde au risque d'hypertension systémique.
La température rectale sera suivie : une hyperthermie altère le pronostic vital de l'animal. En cas d'intoxication au LSD, des signes de rhabdomyolyse seront recherchés.
Le pronostic reste globalement bon en cas de prise en charge rapide.
18 juin 2025
 6 min
6 min

17 juin 2025
 3 min
3 min
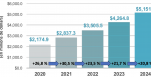
16 juin 2025
 4 min
4 min

13 juin 2025
 4 min
4 min

12 juin 2025
 4 min
4 min

11 juin 2025
 5 min
5 min
