21 novembre 2025
 4 min
4 min

Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.



Sous l'égide de l'ISFM*, un groupe de 8 experts en médecine féline, dont le français Brice Reynolds de l'école vétérinaire de Toulouse, a établi des recommandations pratiques pour le diagnostic et le traitement de l'hypertension chez le chat. Ils identifient quatre points essentiels pour améliorer la prise en charge de cette maladie, fréquente mais « probablement significativement sous-diagnostiquée » faute d'un suivi de la pression artérielle en routine chez les chats reçus en consultation.
Les recommandations viennent d'être publiées dans le dernier numéro du Journal of Feline Medicine and Surgery (article en libre accès, en anglais).
Dans leur publication, les auteurs rappellent que l'hypertension artérielle systémique est le plus souvent secondaire, à une autre maladie (hyperthyroïdie, insuffisance rénale chronique, hyperaldostéronisme, notamment) ou, de manière transitoire, au stress induit par l'effet « blouse blanche ». Mais elle peut être sans cause sous-jacente (13 à 20 % des cas). Elle reste cliniquement inapparente, jusqu'à la survenue de lésions (irréversibles) sur les yeux, les reins, le cœur ou le cerveau. Sa pathogénie demeure trouble à ce jour.
Pour favoriser la détection précoce de la maladie, l'ISFM recommande la mesure régulière de la pression artérielle chez tous les chats, d'autant plus fréquente que le risque d'hypertension augmente :
La mesure de la pression artérielle systolique est effectuée par méthode Doppler (sphygmomanomètre) ou oscillométrie haute définition (HDO). La procédure à suivre a déjà fait l'objet de recommandations (voir ‘En savoir plus'), illustrées par une série de quatre vidéos pratiques en libre accès sur Youtube (traduites en français).
La variabilité des valeurs de pression artérielle mesurées chez le chat en bonne santé ne permet pas de proposer d'intervalles de normalité. Le sexe et la race de l'animal ne semblent pas être des facteurs d'influence. Au contraire de l'âge, confirmé comme tel (comme chez l'homme) : une récente étude a montré une augmentation de la pression artérielle de 1 à 2 mmHg par an à partir de 9 ans dans l'espèce féline. Une valeur de référence déjà élevée (« pré-hypertension ») semble également être associée à un risque plus élevé d'hypertension vraie ultérieure.
Le risque de lésions organiques (organes cibles) est habituellement établi lorsque la pression dépasse 160 mmHg. Mais il dépend aussi de la durée de l'hypertension et de ses écarts dans le temps.
Le groupe identifie toutefois 4 situations dans lesquelles un traitement anti-hypertensif se justifie :
Les experts précisent également les investigations à mener lors d'hypertension, outre la mesure de la pression artérielle : un examen clinique complet incluant l'historique clinique du chat et une évaluation des fonctions cardiaque, neurologique et oculaire (ophtalmoscopie), des examens de laboratoire (analyse urinaire, mesure de la créatinine et/ou diméthylarginine symétrique sérique et des concentrations sanguines de thyroxine, sodium, potassium et chlore) et, le cas échéant, l'exploration par imagerie médicale du cœur et de l'abdomen, la mesure de l'aldostéronémie, etc.
Le traitement de l'éventuelle cause sous-jacente de l'hypertension est primordiale. Mais il n'exclut pas un traitement spécifique de l'hypertension, afin de prévenir les lésions organiques. L'objectif thérapeutique initial est de retrouver une pression artérielle inférieure à 160 mmHg (après une à deux semaines). À long terme, l'abaisser à 150 mmHg paraît approprié. Inversement, l'ISFM recommande de limiter la baisse et rester au-dessus de 110 mmHg.
L'amlodipine est la molécule de choix, administrée per os à la dose de 0,625 mg par animal (0,125 mg/kg). Une dose plus élevée (1,25 mg/chat, 0,25 mg/kg) s'envisage toutefois si la pression artérielle atteint ou dépasse 200 mgHg. Dans ce cas, ou si des lésions organiques sont présentes, un suivi étroit de l'animal est recommandé pendant 24 à 72h (évolution des signes clinique et de la pression artérielle). En l'absence de lésion organique, la pression artérielle sera réévaluée au moins tous les 7 à 10 jours.
Si la réponse au traitement est insuffisante, la dose d'amlodipine peut être doublée, progressivement augmentée jusqu'à un maximum 2,5 mg/chat (0,5 mg/kg). Un traitement adjuvant peut aussi être envisagé.
Une fois la pression artérielle stabilisée, des contrôles réguliers, au moins tous les 3 mois, sont recommandés.
Une thérapeutique « plus agressive » est recommandée pour les cas d'urgence, à savoir l'apparition soudaine de lésions organiques graves et évolutives ou d'une brusque élévation de la pression artérielle, malgré l'absence de preuve clinique de son efficacité et un risque potentiellement plus élevé d'effets indésirables.
L'administration orale d'amlodipine est le traitement préféré et immédiatement effectuée, à la dose de 0,625 à 1,25 mg/chat (0,125 à 0,25 mg/kg). La dose est répétée après 4-8h si besoin, plusieurs fois sans dépasser 2,5 mg/chat sur 24h. Si la voie orale est compromise, un traitement parentéral est envisageable, avec une molécule d'action anti-hypertensive de courte durée (hydralazine, acépromazine, nitroprussiate de sodium, labétalol, esmolol).
Le chat est hospitalisé et la baisse de la pression artérielle doit rester contrôlée (elle est mesurée toutes les 4h). Car dans le cas contraire, voire si une hypotension apparait, une ischémie myocardique, rénale ou cérébrale peut survenir. La pression artérielle est ainsi relevée toutes les 4h jusqu'à atteindre la valeur souhaitée, puis 2 à 4 fois par jour jusqu'à la stabilisation du cas. Un traitement « standard » prend ensuite le relais.
* ISFM : International Society of Feline Medicine (société internationale de médecine féline).
21 novembre 2025
 4 min
4 min

20 novembre 2025
 1 min
1 min
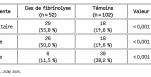
19 novembre 2025
 4 min
4 min

18 novembre 2025
 6 min
6 min

17 novembre 2025
 4 min
4 min
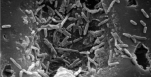
14 novembre 2025
 5 min
5 min
