15 juillet 2025
 6 min
6 min
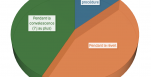
Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.


23 octobre 2023
Méningo-encéphalites d'étiologie inconnue : pas de traitement qui se détache en faveur d'une durée accrue de survie

La corticothérapie reste centrale dans le traitement des méningo-encéphalites d'étiologie inconnue (ou indéterminée) chez le chien, mais le taux de récidive est élevé, et « il y a besoin de traitements visant spécifiquement à prévenir de telles rechutes ».
Telle est la conclusion d'une étude rétrospective multicentrique dano-norvégienne. Les auteurs ont recherché les cas de méningo-encéphalites d'origine inconnue (MEOI) parmi les dossiers médicaux des patients ayant consulté les hôpitaux universitaires des facultés vétérinaires de Copenhague (Danemark) et Frederiksberg (Norvège), entre début 2016 et fin 2021. Les critères d'inclusion reposaient sur la confrontation des examens cliniques (et neurologiques) avec l'interprétation de l'imagerie (IRM, voire scanner si les résultats de LCR étaient suspects) et/ou de l'analyse du LCR. Les cas avérés (post-mortem) de nécro- ou méningo-encéphalite nécrosante chroniques ont également été inclus (considérés comme le diagnostic de certitude de la présence d'une MEOI). Si le chien a survécu plus de 72 h au diagnostic, il fallait au moins une visite de suivi pour qu'il intègre l'étude. Les sujets présentant une néoplasie, ou présentant une autre affection neurologique ou pour lesquels l'histologie n'a pas confirmé avec certitude la présence d'une MEOI étaient également exclus.
Les traitements prescrits (corticoïdes en monothérapie, ou associés à d'autres molécules), les causes de décès/euthanasie étaient notés et précisés lors de l'examen individuel de chaque dossier médical (par exemple la cause de l'euthanasie était associée à la récidive si les dates des deux événements concordaient). Des 103 dossiers médicaux initialement obtenus, 63 ont pu être inclus dans l'étude. Parmi ces sujets, les petites races étaient sur-représentées : 84 % des cas pesaient moins de 15 kg. Plus précisément, l'étude comprend 12 chihuahuas, 9 carlins et 5 Yorkshire terriers. Pour les auteurs, il s'agit d'un biais de recrutement lié à l'implantation citadine des deux hôpitaux. Ces sujets étaient en moyenne âgés de presque 5 ans au moment du diagnostic (entre 7 mois et 13 ans). Dans la majorité des cas (59 %), les chiens ont été présentés en consultation dans la semaine suivant l'apparition des signes cliniques. Toutefois, ce délai pouvait être plus long (pour 9 chiens il dépassait un mois, dont plus de 6 mois pour deux chiens).
Plus d'un chien sur deux (35 sur 63) est décédé au cours de la période étudiée. Un an après le diagnostic, 38 % étaient décédés (mais 18 % perdus de vue). La durée moyenne de survie des sujets était d'un peu moins de deux ans (714 jours, allant de 0 à 1 678 jours). Pour l'analyse de la survie (voir l'illustration principale), les auteurs ont considéré différents groupes selon la thérapie prescrite :
« Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les courbes de survie de ces trois groupes (p=0,31) ». Toutefois, les auteurs préviennent que « la taille limitée de chaque groupe doit être gardée à l'esprit, et un biais potentiel vers des animaux plus sévèrement atteints dans les deux sous-groupes avec des chiens recevant une thérapie combinée doit être pris en compte », puisque les praticiens prescrire plus souvent une association face à des cas « présentant des signes cliniques plus sévères ou ne répondant pas à la corticothérapie seule ». Mais d'un autre côté, la survie prolongée de ces animaux pourrait surtout refléter « la qualité des soins fournie par leurs maîtres, et l'aisance financière de ces derniers », plus qu'une différence d'efficacité entre les traitements. Seule une étude prospective randomisée à l'inclusion pourrait permettre de détecter un effet significatif éventuel de l'un de ces traitements sur la durée moyenne de survie. Mais il n'est pas acquis qu'une telle approche « soit éthiquement acceptable ».
La première cause de décès était la récidive de la MEOI (15 des 35 cas décédés). Elle était suivie de l'absence de réponse au traitement (9 cas), ayant entraîné soit le décès, soit l'euthanasie du chien. Les auteurs rappellent que la récidive de MEOI est démontrée comme associée à une durée plus faible de survie. Ils estiment qu'il « serait très intéressant de prévenir les rechutes et d'examiner si certains schémas thérapeutiques ont un taux de rechute plus faible que d'autres », ce que les effectifs de la présente étude ne permettent pas. Pour les effets secondaires du traitement, 9 chiens étant décédé précocement et 7 ayant été perdus de vue, l'analyse a porté sur un total de 47 sujets. Sans surprise, les effets le plus fréquemment rapportés étaient la polyphagie et la polyuro-polydipsie (79 % des cas dans les deux cas), devant la diarrhée (62 %) et les vomissements (36 %). Il n'y a eu « que des différences mineures pour les effets indésirables selon les groupes de traitement ». Toutefois, d'une part, tous les chiens ont présenté des effets indésirables et d'autre part, sur les 35 chiens décédés, « seuls deux ont été euthanasiés en raison de causes directement liées aux effets indésirables de leur traitement ». L'un a été euthanasié après 99 jours de corticothérapie, en très mauvais état général, et l'autre après 469 jours de traitement associé au léflunomide, également en mauvais état général.
La publication détaille l'état des animaux et les résultats des examens complémentaires. Lors de la consultation, seuls un quart des chiens étaient vigilants, les autres étaient léthargiques (n=40) à comateux (n=3). La majorité (59 %) étaient ataxiques, et la proprioception était affectée pour au moins un membre pour près de deux chiens sur trois (61 %). Un sur deux avait un réflexe réduit à la menace. Une IRM a été réalisée pour 34 d'entre eux, et seuls 3 présentaient un examen jugé normal. Un scanner a été réalisé pour 27 cas, mais l'examen n'a pas identifié de signes inflammatoires pour la majorité d'entre eux (n=19). Les auteurs précisent que la sensibilité du scanner pour ce type d'affection est nettement plus faible que celle de l'IRM. Une analyse de LCR était disponible pour 45 chiens, dont trois présentaient une cytologie normale (les auteurs présentaient une pléocytose). Au bilan, les auteurs estiment qu'il faut poursuivre l'exploration des MEIO, à la fois pour explorer les mécanismes sous-jacents et pour évaluer les schémas thérapeutiques pouvant prévenir les rechutes.
15 juillet 2025
 6 min
6 min
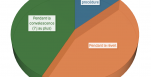
11 juillet 2025
 4 min
4 min

10 juillet 2025
 5 min
5 min

9 juillet 2025
 4 min
4 min

8 juillet 2025
 6 min
6 min

7 juillet 2025
 4 min
4 min
