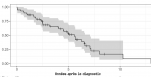6 mai 2025
 5 min
5 min

Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.




« Est-il éthiquement acceptable d'utiliser la chimiothérapie pour le traitement des animaux de compagnie ? » Une praticienne vétérinaire australienne a décidé de mettre les pieds dans le plat, et consacre une publication scientifique à la question. Ce n'est pas une inconnue ‘down under' : elle est aussi la présidente actuelle de l'association des vétérinaires australiens pour le bien-être et l'éthique, titulaire d'une chaire à l'Animal Welfare Trust de l'association vétérinaire australienne (AVA) et a reçu en 2006 le prix Belle Bruce, « qui distingue les 100 plus importantes femmes vétérinaires » en Australie.
Elle estime que la réflexion éthique a été peu développée, et « alors que l'oncologie est une spécialité vétérinaire en plein développement, et que le recours à la chimiothérapie devient plus banal dans le traitement des animaux cancéreux, il est impératif de tenir un débat éthique sur l'utilisation de celle-ci chez les animaux ». Pour cet exercice intellectuel, elle a convoqué « les différents points de vue sur la nature de nos devoirs envers les animaux : les droits des animaux, la théorie utilitariste et celle relationnelle ». Son premier constat est que « les chiens n'ont pas de notion du futur », alors que la chimiothérapie « vise à prolonger leur vie », mais « n'est pas un soin curatif, mais une forme de soin palliatif », dont « le propriétaires ont tendance à surestimer les effets sur la durée de survie ». L'auteure est consciente que certains cancers (lymphomes par exemple) répondent bien à la chimiothérapie (jusque 90 % de rémission, mais 8 % des cancers). Mais « si les traitements offrent une prolongation, la majorité des chiens finit par rechuter ». Elle ajoute, à charge, que ces « chiens vont souffrir des effets indésirables » du traitement. A l'inverse, la tendance à intégrer l'animal de compagnie dans la cellule familiale « fait que les maîtres s'attendent à ce que leur animal ait droit au même niveau de soins que les autres membres de la famille ».
Lorsque le cancer est diagnostiqué en consultation (et hors euthanasie immédiate), l'auteure revient à sa posture de praticienne : « si le cancer peut répondre à une chimiothérapie, il y a deux choix : soit le traiter par chimiothérapie (soin palliatif), soit fournir des soins palliatifs sans chimiothérapie et euthanasier l'animal lorsqu'il souffrira ». Dans sa discussion avec le maître, le vétérinaire pourra se référer à trois théories :
Outre cela, le maître attend du praticien l'évaluation du bien-être de son animal dans les deux options de traitement. Elle souligne qu'outre les effets indésirables d'une chimiothérapie, cette option « comprend de nombreux voyages chez le vétérinaire, et des procédures pouvant être douloureuses ». Aussi, propose-t-elle, pour réaliser cette évaluation, que le praticien réponde à la question « y aura-t-il plus de plaisir que de souffrance et les préférences du chien seront-elles satisfaites alors que l'animal sera probablement confiné pendant son traitement et ne pourra pas interagir avec la famille de manière habituelle du fait du risque pour les humains liés à la chimiothérapie ? » A l'inverse, elle précise que l'option des soins palliatifs sans chimiothérapie peut être présentée au maître comme « pour lui permettre d'arriver à accepter de perdre son animal ». Elle rappelle aussi que cette option « est fréquemment choisie du fait du coût, des exigences et de l'incertitude du pronostic de la chimiothérapie ». L'auteure rappelle aussi que le maître peut avoir des vues différentes de celles du praticien. Pour ce dernier et pour l'oncologue, « le cancer est parfois vu comme juste une autre maladie qui se traite ». Alors que le propriétaire l'appréhende à travers son expérience et celle de son entourage – d'où l'importance du consentement éclairé sur tous les aspects de la chimiothérapie, y compris que cela « fait appel à des médicaments qui sont mutagènes, cancérogènes, tératogènes et peuvent être irritantes ».
Au bilan, pour aider le praticien à nourrir la discussion avec le maître de l'animal, elle illustre l'utilité de trois théories éthiques sur les devoir dus à l'animal.
Selon le point de vue des droits de l'animal, les intérêts du chien prévalent, et « toute souffrance évitable doit être évitée ». Dans ce contexte, « le praticien proposera la chimiothérapie si elle offre une survie prolongée, mais en tenant compte des souffrances induites et des intérêts du maître ». En d'autres termes, « le droit à la vie de l'animal se fait aux dépens de son bien-être et des charges émotionnelle et financière du propriétaire ». Mais, rappelle l'auteure, selon cette approche, « puisque les animaux ne conceptualisent pas la mort, la qualité de vie devrait prendre le pas sur la quantité de vie » dans la prise de décision.
Selon le point de vue utilitariste, l'évaluation coût-bénéfice de la décision de traiter « prend en compte le bien-être de l'animal, la qualité de vie du maître, le bien-être de l'entourage et [même] du vétérinaire » et jusqu'à l'intérêt sociétal. C'est clairement une approche plus délicate, puisque chaque sujet a une même importance : cette approche « met en valeur la dimension éthique unique de la profession vétérinaire ». « Si le propriétaire se satisfait d'une euthanasie de son chien cancéreux et d'acheter un nouveau chien, c'est une solution correcte » - d'autant plus que l'animal souffrait. Même si, en pratique, l'euthanasie est plus souvent motivée par l'incapacité et la charge émotionnelle de gérer la fin de vie de l'animal que la douleur. Quant au choix entre analgésie et vigilance, les hédonistes choisiront de prendre en charge la douleur de l'animal, les perfectionnistes moins.
Le point de vue relationnel (ou contextuel) met l'accent sur l'unicité de la relation entre le maître et son animal. Le praticien prend alors sa décision au vu « de la nature du lien entre le maître et l'animal ». Dans ce contexte, « la chimiothérapie sera utilisée en espérant prolonger la vie de l'animal, donc faire durer ce lien autant que possible ». C'est « quand ce lien ne peut plus être maintenu que l'euthanasie devient acceptable ». En particulier, la souffrance de l'animal peut affecter ce lien, mais « si le propriétaire retire un bénéfice émotionnel de prodiguer les soins palliatifs à son animal, la décision est plus difficile » à prendre.
Si ces éléments de réflexion – aux côtés de l'évaluation du bien-être individuel de l'animal, peuvent « aider les praticiens à ‘tracer la limite' » dans les choix proposés, l'auteure souligne que « dans le même temps, celui-ci doit garder à l'esprit que sa responsabilité primaire, réglementaire comme éthique, est l'animal et non le maître ».
6 mai 2025
 5 min
5 min

5 mai 2025
 4 min
4 min

2 mai 2025
 5 min
5 min

30 avril 2025
 4 min
4 min
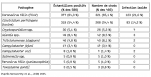
29 avril 2025
 5 min
5 min
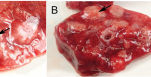
28 avril 2025
 4 min
4 min