28 août 2025
 4 min
4 min
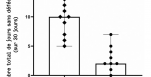
Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.


26 août 2025
Impact écologique de l'IA : un enjeu de la révolution numérique à considérer avec raison

Contrairement à l'image immatérielle souvent véhiculée, l'intelligence artificielle (IA) est profondément enracinée dans le monde physique. Les données qu'elle traite transitent par des câbles, sont stockées sur des disques, analysées par des puces qui chauffent, refroidies par de l'eau ou de l'air. Chaque interaction avec un modèle comme ChatGPT consomme de l'énergie. Une simple requête sur GPT-3.5 (modèle déconnecté ce jour) émettait environ 4,3 g de CO₂. Rapportée à des millions d'utilisations quotidiennes, l'addition devient lourde (voir aussi le tableau en bas de ce Fil).
À ce jour, il ne semble pas y avoir de consensus à propos de l'empreinte carbone d'un modèle comme GPT-4.5. Selon les analyses, les chiffres varient de 0,03 à 4,5 g de CO₂ par requête. À titre de comparaison, une requête Google classique émet environ 0,2 g.
À cela s'ajoute l'eau nécessaire au refroidissement des serveurs – jusqu'à 0,5 l par conversation (dont parfois 60 % par évaporation donc non recyclable) – et l'impact environnemental des matériaux nécessaires à la fabrication des unités de traitement graphique (GPU), serveurs et autres composants. Extraction minière, transport, assemblage, recyclage difficile… L'empreinte de l'IA ne se résume pas au carbone. Elle engage aussi notre rapport aux ressources rares.
Que pèse l'IA dans l'empreinte d'une clinique vétérinaire ? Prenons un exemple concret basé sur une étude menée à la clinique vétérinaire VETONIMO de Vandœuvre-lès-Nancy (structure d'activité canine, généraliste et référé). Les données issues du bilan carbone sont les suivantes :
Ce bilan montre que l'IA générative, aussi spectaculaire soit-elle, représente une empreinte marginale dans le cadre vétérinaire. Ce n'est pas une raison pour l'ignorer, mais un appel à prioriser les efforts afin d'agir sur les secteurs les plus gourmands.
Dans une récente vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, il est affirmé que « l'IA consommera 99 % de l'énergie mondiale d'ici 2030 ». C'est évidemment faux : selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les centres de données (data centers) – IA incluse – représentent 1,5 % de la consommation actuelle totale d'électricité, et ce taux devrait atteindre 3,2 % d'ici 2030. C'est une progression rapide, mais bien éloignée de la caricature catastrophiste véhiculée.
Par ailleurs, ces chiffres ne tiennent pas compte des gains d'efficacité. Les modèles d'IA sont chaque année plus performants, les processeurs plus économes, et l'optimisation logicielle réduit la consommation par tâche accomplie. Utilisée intelligemment, l'IA peut même réduire l'empreinte carbone d'un professionnel : produire un rapport via 10 requêtes ciblées consomme souvent moins que passer 6 heures à le rédiger manuellement avec recherche et documentation.
La vraie question, quant à la démocratisation de l'usage de l'IA, n'est pas tant le temps qu'on y gagne, mais ce que l'on en fait. Imaginons un praticien qui, ayant confié à ChatGPT la rédaction d'un rapport, s'offre ensuite le luxe rare de s'étendre dans l'herbe, les bras croisés derrière la tête, les paupières mi-closes, attentif au chant des merles. Aucun moteur, aucun écran, aucun clic. Dans ce scénario, l'équation écologique penche en faveur de l'intelligence artificielle. À l'inverse, si ce même praticien s'attaque plutôt à d'autres tâches, toutes plus énergivores les unes que les autres (appels, déplacements, chirurgie, commandes express…), l'IA n'aura pas réduit son impact carbone, elle en aura optimisé une partie tout au mieux. Car il existe une corrélation directe, tenace, entre productivité et consommation d'énergie. Plus on fait, plus on consomme. Et plus on consomme, plus on creuse. L'enjeu n'est donc pas seulement de déterminer ce que fait l'IA à la planète, mais d'évaluer les conséquences du vide qu'elle libère.
En pratique, faut-il arrêter l'IA pour sauver la planète ? La réponse est non. Faut-il réfléchir sérieusement à son impact ? La réponse est oui, mais sans tomber dans l'excès. Un email avec une pièce jointe lourde peut émettre jusqu'à 50 g de CO₂, et une heure de visioconférence HD, près de 1 kg, tandis qu'une requête IA bien formulée se situe entre 0,05 et 4,3 g selon les modèles et les usages.
La question à se poser devient alors : à quelles fins mobilise-t-on ces ressources ? Et quels sont les leviers concrets à notre disposition dans nos pratiques quotidiennes pour réduire nos émissions sans sacrifier notre efficacité ni notre confort professionnel ?
Voici quelques pistes pour une IA plus vertueuse dans le quotidien vétérinaire.
À l'échelle planétaire, certains rêvent de déplacer les IA loin des hommes, là où la chaleur ne gêne plus personne. Le projet chinois « Three-Body Computing Constellation », par exemple, envisage d'envoyer des serveurs en orbite, dans le silence glacé de l'espace, où les calories générées par les calculs pourraient se dissiper sans troubler notre atmosphère. Le 14 mai dernier, une fusée Longue Marche 2D a lancé 12 premiers satellites depuis le centre de Jiuquan, marquant le début de ce projet révolutionnaire. Mais l'idée, séduisante sur le papier, se trouble dès qu'on la frotte au réel : pour faire léviter ces centres de données dans les hauteurs célestes, il faudra d'abord forger des serveurs spécifiques, puis les hisser hors de l'attraction terrestre sur des fusées gourmandes en carburant. Le bilan carbone de chaque gramme expédié là-haut mérite d'être regardé à la loupe. Comme souvent, l'écologie commence par une question simple : combien cela coûte-t-il avant que cela commence à rapporter ?
En résumé, l'IA n'est pas hors-sol, mais elle ne constitue pas le problème principal.
28 août 2025
 4 min
4 min
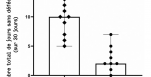
27 août 2025
 6 min
6 min

25 août 2025
 4 min
4 min

22 août 2025
 5 min
5 min

21 août 2025
 4 min
4 min
