9 décembre 2025
 4 min
4 min

Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.


29 juillet 2025
Le « management à la française » serait de médiocre qualité en comparaison des pratiques managériales internationales

Dans le cadre de son programme de travail, l'Inspection Générale des Affaires sociales (IGAS), rattachée au ministère des affaires sociales, a publié en juin 2024 un rapport sur les pratiques managériales en France et leur comparaison à celles d'autres pays, en particulier l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et la Suède.
Ce travail s'est intéressé à 4 domaines d'activité : l'automobile, l'hôtellerie–restauration, le digital et l'assurance. Les investigations avaient pour objectif d'analyser les liens entre les pratiques managériales des entreprises et les politiques sociales.
Outre leur effet sur la performance des entreprises, il est effectivement admis que les politiques managériales exercent une influence sur la qualité de vie et les conditions de travail, mais aussi les politiques sociales. Ces dernières sont les politiques menées par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux dans des objectifs d'intérêt général. Essentiellement fondées sur la mutualisation et la gestion des risques (la maladie, la dépendance, le chômage, etc.), ces politiques sont très nombreuses et variées en fonction des pays. Il est cependant possible de définir un périmètre autorisant les comparaisons entre différents pays européens.
Le rapport de l'IGAS regroupe les résultats de plusieurs études internationales qui montrent les spécificités de la France en termes de management. Même s'il existe évidemment des contrastes entre les types d'entreprises, selon leur taille et leur secteur d'activité, la situation française se singularise globalement à plusieurs titres.
Toutes les données convergent pour montrer que les qualités relationnelles se détériorent avec l'éloignement hiérarchique. Ainsi, en France, 37 % des salariés ne font pas confiance à la direction de leur entreprise. Là encore s'observe le différentiel entre la France et les autres pays européens : la différence du niveau de confiance dans la direction de l'entreprise est inférieure de 10 points dans notre pays par rapport à la moyenne de l'Union Européenne. L'Irlande enregistre un résultat de 15 % supérieur à la France sur cet item de la confiance dans la direction. L'Allemagne atteint même une supériorité de 18 %.
La quasi-totalité des interlocuteurs de la mission font un constat identique : le management est encore très vertical, descendant, en France. Ce caractère directif des encadrants laisse peu de place à l'autonomie. La France se caractérise aussi par un éloignement hiérarchique important, un des plus forts mesurés en Europe.
Cela se traduit chez les managers par un indice de contrôle de l'incertitude très élevé (c'est-à-dire des personnes mal-à-l'aise avec l'imprévu et l'ambiguïté), ce qui est peu propice à développer de la motivation chez les salariés. Cet indice de contrôle est 2 fois plus élevé en France qu'aux États-Unis, et 3,5 fois plus élevé qu'en Suède. En comparaison, seul le Japon apparaît, dans d'autres études, comme ayant davantage de contrôle pour éviter les imprévus. En France cet aspect du management va de pair avec une faible vision long terme et un individualisme élevé.
Différentes données publiées mettent en lumière une difficulté typiquement française concernant la reconnaissance au travail : 56 % des salariés français seulement estiment que leur travail est reconnu à sa juste valeur, contre 72 % au Royaume Uni et 75 % en Allemagne.
L'origine de cette différence ne réside pas dans le niveau de rémunération, car les grilles de salaire ne sont pas moins avantageuses en France. Elle tiendrait avant tout aux écarts sur l'utilisation de leviers de reconnaissance, tels que le droit à l'erreur et à l'essai, et l'encouragement à la prise d'initiatives.
Une autre source mentionnée par les auteurs du rapport de l'IGAS fait apparaître que 30 % des travailleurs français estiment qu'ils ne reçoivent pas le respect et l'estime que mérite leur travail. La reconnaissance du travail est visiblement un point de faiblesse du management à la française.
En France, la formation des managers est considérée comme trop académique et peu tournée vers la coopération, malgré des efforts dans ce sens sur les 20 dernières années. Ce constat s'enracine dans le système éducatif français, peu ouvert à l'acquisition des compétences socio-comportementales. Ce système valorise mal le sens du collectif et se singularise par un climat de défiance très élevé. Plus d'un tiers des élèves français considèrent que les relations ne sont pas bonnes avec la plupart de leurs enseignants, soit l'un des plus hauts niveaux de difficultés au monde.
Les comparaisons révèlent qu'une faible part du temps d'apprentissage est dédiée à la compréhension des organisations et de son volet humain, tant dans les écoles d'ingénieurs que dans les écoles de management. Dans ces dernières, les enseignements liés à la finance, au marketing ou à la logistique sont majoritaires. Des expérimentations ou des initiatives pour contrer cet état de fait sont en cours et semblent indiquer, heureusement, une inflexion. Des démarches innovantes privilégiant les apprentissages centrés sur un management plus coopératif et tourné vers la qualité de vie au travail font partie des recommandations actuelles.
En outre, dans les entreprises françaises, la promotion interne est perçue comme moins développée que les recrutements externes. Elle est aussi vue comme moins fondamentale par les managers. En France, seuls 49 % des salariés affirment avoir des possibilités d'évolution professionnelle dans l'entreprise contre 65 % en Allemagne et 68 % au Royaume-Uni.
Enfin, le système français aboutit à une moindre présence des femmes parmi les encadrants. Leur proportion n'est que de 37 % parmi les managers, contre 50 % au sein de la population salariée.
La tendance de l'évolution des attentes vers un management davantage disponible et à l'écoute, vers plus d'horizontalité, s'est accélérée dans les années post-Covid. L'amélioration des pratiques managériales avec davantage de confiance et d'autonomie est d'ores et déjà perçue par les cadres. En contrepartie toutefois, elle entraîne une charge de travail supérieure pour les managers.
Le rapport de l'IGAS a fait réagir un certain nombre de formateurs et de chercheurs français spécialisés dans la discipline, lesquels dénoncent une vision étriquée du management, « une définition rabougrie » telle que proposée dans le rapport. Ils critiquent à la fois les constats des rapporteurs, qui ne se sont pas assez intéressés à toutes les dimensions du management, en particulier en termes d'impact sur l'organisation, et qui ont fait la part belle aux très grandes entreprises au détriment des TPE/PME. Ils récusent également les recommandations de l'IGAS pour améliorer la situation, qui prônent l'intervention de la puissance publique et des politiques sociales pour redresser la barre !
Le seul véritable point de consensus repose sur la nécessité de formations de grande ampleur au management, en s'appuyant sur la solidité des savoirs et des expériences et grâce à un financement public.
Car le management est un déterminant essentiel de la santé des salariés. Il est ainsi également un facteur majeur de la qualité du travail, et donc au final de la performance économique des entreprises.
9 décembre 2025
 4 min
4 min

8 décembre 2025
 5 min
5 min
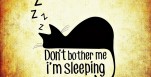
5 décembre 2025
 3 min
3 min

4 décembre 2025
 5 min
5 min

3 décembre 2025
 5 min
5 min

2 décembre 2025
 4 min
4 min





