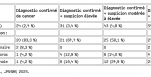15 mai 2025
 7 min
7 min

Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.



Le terme de race canine n'est apparu qu'au XVIIIe siècle. Il était défini comme « une sous-espèce aux caractéristiques physiques définissables, qui se reproduirait de manière fiable si ses membres étaient croisés entre eux ». La première structure officielle de sélection canine, l'English kennel club, fut créé en 1873 et la Société centrale canine française en 1882.
Environ 400 races canines différentes sont actuellement recensées dans le monde mais les spécialistes de l'élevage s'inquiètent de l'évolution des chiens de races : appauvrissement génétique, individus hypertypés, chiots vendus sans pedigree, chute de l'influence des clubs de races, apparition de chiens hybrides (« designer dogs »)… Dans un long article publié en libre accès, des cynophiles scandinaves explorent différentes possibilités pour tenter d'assainir la situation.
En effet, les races canines ont initialement été sélectionnées sur des critères de travail (chasse, garde, pistage…), mais le phénotype a progressivement pris une importance majeure dans de très nombreux cas. Des lignées distinctes (« travail » ou « beauté ») sont apparues, créant « une race à l'intérieur d'une autre race ». En outre, de nombreuses races ont été créées à partir d'un nombre limité de chiens, et aujourd'hui encore, les reproducteurs représentent une minorité d'individus au sein de la race.
La diffusion de mutations génétiques délétères au sein des races canines a été facilitée par l'augmentation de l'homozygotie et la perte progressive de la diversité génétique, dans des populations de plus en plus consanguines.
La formulation des standards (et leur interprétation par les juges) a favorisé l'exagération progressive de certains caractères phénotypiques. Les multiples problèmes de santé observés dans les races brachycéphales (bouledogues français et anglais, carlin, entre autres) sont les exemples les plus frappants des effets indésirables de ces « hypertypes ». Mais la sélection sur les plis cutanés (sharpeï) ou sur un crâne court et arrondi (épagneul et cavalier king-charles, chihuahua) est également néfaste à la santé et au bien-être des chiens.
Bien que les standards de la Fédération cynologique internationale (FCI) contiennent désormais la phrase suivante, « tout écart par rapport aux points précédents doit être considéré comme un défaut et la gravité avec laquelle le défaut doit être considéré doit être exactement proportionnelle à son degré et à son effet sur la santé et le bien-être du chien », il est encore possible de progresser dans l'interprétation des standards.
La popularité des différentes races fluctue dans le temps, en fonction de l'évolution des styles de vie (liée à l'urbanisation) et des effets de mode. Ces derniers entraînent régulièrement un pic de production de chiots dans les races en vogue, le plus souvent en dehors des structures d'élevage officielles. Les clubs de race perdent donc de leur influence, notamment en ce qui concerne les chiens de compagnie.
Le grand public est aussi de mieux en mieux informé des problèmes de santé inhérents à certaines races. Même si de nombreuses études ont été réalisées sur le sujet à l'initiative des clubs de races, il est estimé que le grand public n'a commencé à être sensibilisé aux effets délétères de la sélection des chiens de race qu'en 2008, avec notamment la diffusion d'un documentaire de la BBC, « Pedigree dogs exposed ».
Les chiens issus de croisements volontaires entre deux races, hybrides nommés « designer dogs », sont apparus dans les années 1980 et sont devenus très populaires dans certains pays. Au Royaume-Uni, ils représenteraient actuellement 6,7 % de la population canine.
Le labradoodle (résultat du croisement entre un labrador et un caniche) fut le premier designer dog à être médiatisé, et de nombreux autres ont suivi : le cockapoo (cocker x caniche), le cavapoo (cavalier king-charles x caniche), le schnoodle (schnauzer x caniche), le maltipoo (bichon maltais x caniche)…
L'utilisation du caniche visait au départ à produire des chiens « hypoallergéniques » pour leurs propriétaires, mais l'hypothèse s'est révélée en grande partie fausse. De plus, d'après une enquête de 2022, 18,2 % des propriétaires de « doodles » se plaignent des contraintes et du coût liés au toilettage de ces chiens.
Une fois la boîte de Pandore ouverte, la liste des combinaisons n'a cessé de s'allonger, et sont ainsi apparus le puggle (carlin x beagle), le pomsky (poméranien x husky), le chorkie (chihuahua x Yorkshire terrier), etc.
La décision d'acquérir un designer dog est largement motivée par l'apparence originale du chien (le labrador ou le cocker par exemple), mais les amateurs sont souvent persuadés que ces hybrides sont en meilleure santé que les chiens de race pure. Cette croyance est directement liée au concept d'hétérosis (ou de vigueur hybride), qui n'est cependant valable qu'à la première génération (F1). Or, si les designer dogs continuent à se développer, ils seront sans doute à l'origine de nouvelles races. C'est le cas en Suisse, où le labradoodle est désormais une race enregistrée. En France, les adeptes du pomsky militent pour la reconnaissance officielle de la race. L'effet positif potentiel de l'hétérosis est donc susceptible de s'estomper avec le temps et les designer dogs risquent de présenter les mêmes problèmes de santé que ceux observés dans les races traditionnelles.
De plus, même en cas de croisement, la santé des descendants est largement influencée par le patrimoine génétique des parents : présence de mutations génétiques délétères, prédisposition à certaines maladies, degré de consanguinité… Des études ont montré que le croisement de deux races prédisposées à l'obésité pouvait conduire à un degré d'obésité encore plus élevé chez le chien hybride.
Les quelques études évaluant la santé des designer dogs n'ont pas donné de résultats très encourageants…
Bien que peu d'études aient été publiées à ce jour sur la santé des designer dogs, il semble donc que l'hypothèse selon laquelle leur résistance aux maladies serait supérieure à celle des races d'origine est surestimée. De plus, sauf s'ils finissent par devenir des races à part entière, la santé des designer dogs ne fera pas l'objet du suivi systématique mis en place dans la plupart des races officiellement reconnues. Enfin, la fixation des caractères recherchés chez les différents types de designer dogs risque de favoriser la consanguinité et faire apparaître les mêmes problèmes que dans les races pures.
Les races canines se distinguent aussi par leur comportement, et il est largement admis que ce dernier est héréditaire dans une certaine mesure. En F1, il est donc attendu que les designer dogs présentent des comportements intermédiaires entre ceux de leurs parents.
Cette attente est généralement vérifiée, mais il existe des exceptions notables. Les résultats d'une étude révèlent par exemple des scores plus élevés d'agression et de peur envers les autres chiens chez le goldendoodle que chez les races parentales.
Les auteurs de l'article appellent à considérer la santé et le bien-être des chiens comme prioritaires par rapport à l'apparence. Ils encouragent notamment à abandonner la pratique d'une consanguinité trop poussée et la recherche de conformations extrêmes.
L'élevage de chiens de race reste nécessaire : aux partisans de son arrêt pur et simple, les auteurs objectent qu'une approche aussi extrême ne résoudra pas forcément les problèmes de santé. Comme évoqué plus haut, les designer dogs ne sont pas exempts de maladies héréditaires.
À ceux qui conseillent d'adopter un chien dans un refuge plutôt que d'acheter un chien de pure race, les auteurs répondent que le nombre de chiens abandonnés ne suffira pas à satisfaire la demande du grand public. D'autre part, l'achat d'un chien dont le format, l'apparence et le comportement sont compatibles avec les attentes du propriétaire facilite la mise en place d'une bonne relation entre les deux individus.
Loin d'être un obstacle, l'élevage de chiens de races pures peut au contraire faciliter la surveillance de la bonne santé des chiens puisque la traçabilité acquise à travers les pedigrees et les livres des origines des différents pays permet de suivre les résultats des programmes d'élevage sur plusieurs générations. Il convient d'encourager les programmes de dépistage des maladies les plus courantes au sein de chaque race et d'utiliser les tests génétiques pour identifier les individus porteurs de maladies héréditaires avant qu'ils ne reproduisent. Le concept de « valeur génétique » a fait son entrée dans le monde de la cynophilie, mais sa mise en pratique varie considérablement d'un pays et d'une race à l'autre.
Pour lutter contre la diminution progressive de la diversité génétique, il est important de maintenir une taille de population reproductrice élevée et de promouvoir la diversité plutôt que l'uniformité au sein des races.
Certains experts n'hésitent pas à encourager aussi le rebooting, qui consiste à effectuer des croisements ponctuels avec d'autres races (outcrossing). Cette stratégie a par exemple été mise en place chez le chien norvégien de macareux (le lundehund) et chez le setter irlandais rouge et blanc. En 2023, le Swedish kennel club et le Finnish kennel club ont approuvé des projets d'outcrossing pour le cavalier king-charles.
La stratégie d'outcrossing est en général limitée dans le temps, mais les registres généalogiques de la race peuvent aussi rester ouverts. Cela a par exemple été le cas lors du processus de réhabilitation du chien de ferme dano-suédois initiée dans les années 1980. Une fois évalués par un juge, les chiens qui présentent une ressemblance phénotypique avec le chien de ferme danois-suédois peuvent être autorisés à reproduire et être inscrits au registre de la race.
Le Kennel club finlandais a aussi ouvert ses registres pour le Jack Russell terrier, le berger lapon, le spitz de Norboten, le berger des Pyrénées et le chien finnois de Laponie. Le Kennel club danois a fait de même pour le bouledogue anglais, le bouledogue français et le carlin : un chien peut être inscrit si son évaluation phénotypique est satisfaisante et qu'il n'obtient pas une note supérieure à 1 lors de l'évaluation du syndrome obstructif respiratoire.
Selon les auteurs de cette publication, le monde de l'élevage canin doit impérativement se réformer pour améliorer la santé globale des chiens de race. S'il ne le fait pas, la publicité négative et les pressions exercées par les associations de protection animale pousseront les gouvernements à légiférer de manière autoritaire, ce qui pourra conduire à l'interdiction définitive de certaines races.
15 mai 2025
 7 min
7 min

14 mai 2025
 3 min
3 min

13 mai 2025
 4 min
4 min

12 mai 2025
 7 min
7 min

9 mai 2025
 5 min
5 min