12 septembre 2025
 5 min
5 min

Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.


15 septembre 2025
Infertilité pré-conceptionnelle chez la chienne : la conduite de l'élevage est le plus souvent en cause
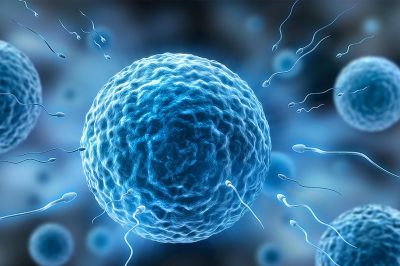
Une étude menée en France sur 27 221 chiennes avait estimé à 82 % le taux de mise bas normal attendu. Lorsqu'un éleveur consulte pour un problème d'infertilité, trois facteurs pouvant perturber la fécondation sont à considérer en priorité : la gestion de l'élevage, la fertilité de la chienne (capacité à la conception puis à mener une gestation à terme) et la fertilité du chien reproducteur.
Une revue bibliographique récente détaille la démarche diagnostique et les solutions à proposer lors d'un bilan de fertilité. Seuls les éléments qui concernent la conception chez la chienne sont résumés dans ce Fil, mais une autre étude a estimé que les facteurs liés au mâle sont responsables de 40 à 50 % des échecs de gestation.
L'infertilité d'une chienne est un problème multifactoriel qui nécessite de prendre en compte la santé générale de la chienne mais aussi le contexte global de l'élevage, car une mauvaise gestion est responsable de 40 à 50 % des échecs de reproduction.
L'âge de la chienne et les conditions de la saillie sont les causes les plus fréquentes, mais la sélection génétique, l'alimentation et le stress environnemental jouent également un rôle.
Une chienne doit avoir atteint un niveau de développement statural satisfaisant et présenter un indice de condition corporelle idéal avant d'être mise à la reproduction. Les effets négatifs de l'insuffisance pondérale et, inversement, du surpoids sur la fertilité sont aujourd'hui bien documentés.
Ainsi, les chiennes de poids insuffisant présentent souvent des cycles irréguliers et des difficultés à maintenir la gestation. L'obésité, elle, est associée à une hyperprolactinémie susceptible d'affecter la production de LH ; elle modifie aussi les concentrations du facteur de croissance IGF-1 qui influence la fonction ovarienne. Les facteurs inflammatoires sécrétés par les cellules adipeuses (tels que le TNF-α) peuvent également interférer avec l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique.
En outre, la fertilité des chiennes diminue avec le temps. Le développement d'une hyperplasie endométriale kystique pourrait l'expliquer en grande partie car elle nuit à l'implantation de l'embryon tout en facilitant le développement d'une infection utérine. Or, selon une étude, l'incidence de cette affection est inférieure à 7 % chez les chiennes de moins de 2 ans et supérieure à 60 % chez celles de plus de 6 ans.
La cause la plus fréquente d'échec de la conception est une mauvaise synchronisation entre l'ovulation et la tentative de fécondation.
Chez la chienne, les ovocytes sont immatures lors de l'ovulation : la fécondation ne devient possible que 48 à 83 heures après. Si le mâle est disponible, un accouplement quotidien peut avoir lieu dès le lendemain de l'ovulation et jusqu'au 3e jour après. Si un seul accouplement est possible ou lors d'insémination artificielle (surtout avec du sperme congelé), le moment idéal sera le 2e ou le 3e jour après l'ovulation.
L'idéal est de réaliser des frottis vaginaux, pour repérer l'apparition de l'œstrus avant de doser la progestérone (et la LH) dans le but de détecter l'ovulation prochaine, mais certains éleveurs continuent à programmer les accouplements entre le 12e et le 14e jour après le début des chaleurs, sans tenir compte de la variabilité du cycle des chiennes.
L'échographie (trans-abdominale ou trans-rectale) permet de surveiller la croissance folliculaire, de détecter l'ovulation en cas de suspicion de cycles anovulatoires et d'observer la formation du corps jaune.
Lorsque le cycle œstral est irrégulier, il convient de rechercher un déséquilibre endocrinien ou un dysfonctionnement ovarien.
En matière d'endocrinopathies :
Un traitement hormonal peut aussi affecter le cycle ovarien, le propriétaire sera donc questionné à ce sujet.
Un cycle anovulatoire se caractérise par une augmentation du taux de progestérone qui n'atteint pas le taux nécessaire à l'ovulation en fin d'œstrus. Il peut s'expliquer par une production insuffisante de GnRH par l'hypothalamus ou par une perturbation de la production ovarienne d'œstrogènes qui empêche l'apparition du pic de LH ou la réponse ovarienne à un pic de LH normal.
Les kystes ovariens représentent jusqu'à 80 % des affections ovariennes. Uni- ou bilatéraux, ils se développent sous forme unique ou de maladie polykystique. Les kystes folliculaires peuvent notamment être responsables d'un œstrus persistant.
Enfin, des tumeurs ovariennes peuvent être responsables d'un œstrus persistant (confirmé par des frottis vaginaux kératinisés répétés durant plus de 21 jours) ou d'un anœstrus prolongé. Les tumeurs épithéliales sont plus souvent bilatérales que les autres tumeurs, et la présence de métastases est rapportée dans environ 48 % des cas. Une échographie abdominale permettra de détecter les tumeurs mais aussi des signes de métastases locales ou à distance, dans d'autres organes abdominaux.
Chez une chienne infertile qui présente des cycles normaux, il est important de rechercher des troubles utérins.
Les anomalies congénitales utérines (utérus unicorne, agénésie segmentaire d'une corne hypoplasie de la corne utérine…) sont très rares, mais elles peuvent avoir un impact sur la fertilité. Une échographie des chiennes infertiles sera donc systématiquement réalisée.
L'endométrite est considérée comme une cause post-conceptionnelle d'infertilité. Dans certains cas, l'arrivée du sperme dans l'utérus pourrait déclencher une réponse inflammatoire de l'endomètre et conduirait à une endométrite. Le diagnostic échographique passe par la visualisation de liquide dans les cornes utérines. Dans une étude portant sur 26 chiennes infertiles, environ un quart (26 %) présentait une cytologie utérine compatible avec une endométrite et dans 70 % des cas, une croissance bactérienne positive a été observée sur les prélèvements utérins.
Le microbiote de l'utérus canin est encore mal caractérisé mais des données récentes suggèrent que l'utérus de la chienne n'est pas un environnement stérile : des bactéries telles que Bacillus spp. et Pseudomonas spp. ont en effet été détectées dans l'utérus de chiennes cliniquement normales et fertiles. Chez la jument et chez la femme, un déséquilibre du microbiote endométrial (dysbiose) a été associé au développement d'une endométrite subclinique ou chronique, une cause reconnue d'infertilité. Ces résultats soulignent l'importance de la composition du microbiome de l'appareil reproducteur, même en l'absence d'infection manifeste. Les cultures effectuées à partir d'un prélèvement vaginal reflètent en revanche rarement ce qui se passe dans l'utérus.
Plusieurs agents infectieux ont été identifiés comme responsables de cas d'infertilité. C'est notamment le cas de Brucella, Mycoplasma canis, l'herpèsvirus, le parvovirus, Toxoplasma gondii et Neospora caninum. Il est donc important d'exclure la présence d'un agent pathogène chez une chienne infertile et de veiller à identifier des bactéries zoonotiques telles que Brucella spp.
Par ailleurs, chez la chienne, l'involution de l'utérus après la mise-bas demande environ 84 jours ; il faut donc à peu près 3 mois pour que l'utérus soit prêt à accueillir une nouvelle portée. Chez les chiennes ayant un cycle court (chaleurs tous les 4 mois par exemple), il est recommandé de laisser l'utérus au repos pendant au moins un ou deux cycles. Si le cycle doit être induit médicalement, il est conseillé d'attendre au moins 5 mois après le dernier début de chaleurs.
En pratique, lorsqu'une chienne est présentée pour « infertilité », la consultation doit intégrer une anamnèse approfondie, portant sur les conditions d'hébergement, le statut vaccinal, le protocole de vermifugation, le mode d'alimentation, les conditions de quarantaine lors des voyages et expositions, les antécédents médicaux, les traitements éventuels… Les performances reproductives antérieures sont également à documenter : antécédents reproductifs dans la lignée, régularité des cycles et conditions de mise à la reproduction.
12 septembre 2025
 5 min
5 min

11 septembre 2025
 4 min
4 min

10 septembre 2025
 5 min
5 min

9 septembre 2025
 4 min
4 min

8 septembre 2025
 4 min
4 min
